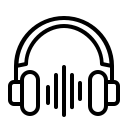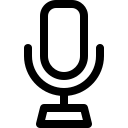Notre enquête
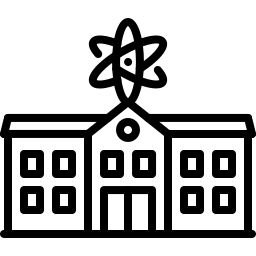
Luc Bodiguel & Marcel Kuntz
Luc Bodiguel et Marcel Kuntz sont tous deux présidents de recherche au CNRS, respectivement à Nantes et Grenoble-Alpes. Ils ont travaillé sur la question des OGM/NTG, d’une part, du point de vue juridique pour M. Bodiguel, et d’autre part, sur l’aspect biologique et génétique pour M. Kuntz. Nous sommes très heureux qu'ils aient accepté de nous aider dans la réalisation de ce projet et les remercions. Ils nous ont apporté une aide précieuse à la récolte d'informations de qualité afin d'avoir un fond théorique fiable sur la controverse étudiée.
Ces deux entretiens se sont révélés particulièrement utiles pour comprendre la manière dont la controverse s’imprègne dans la perception publique et dans la sphère politique. Ce qu’il est ressorti de manière unanime, c’est que les NTG sont des technologies “comme les autres” et qu’elles ne sont pas intrinsèquement “bonnes” ou “mauvaises”. C’est l’utilisation qu’on fait de ces technologies qui détermine leurs impacts. La méfiance envers les OGM ne vient pas seulement d’un manque d’information, elle vient aussi d’un contexte historique de scandales et de manipulations d’informations qui ont déclenché une médiatisation et une opposition d’acteurs. Celle-ci nourrit plusieurs débats en Europe, sur la question juridique notamment, le précautionnisme dont la population fait preuve est-il la bonne manière de réguler les OGM/NTG ? Cette question ne fait pas l’unanimité, en revanche, les différents courants de pensées se mettent d’accord sur le fait que les politiques en vigueur ne sont ni à jour, ni adaptées à la situation. L’incertitude quant aux conséquences à long terme de l’utilisation des différentes techniques génomiques est également un sujet de discorde. Avons-nous atteint une maîtrise des techniques et des incertitudes suffisantes pour écarter totalement les risques ? C’est une question que se posent les chercheurs. L’un des arguments majeurs contre les NTG est qu’ils ne sont « pas naturels », ce qui alimente les inquiétudes autour des risques. De l’autre côté, les opposés tiennent un discours qui dit que de tout temps, dans les champs, des mutations, donc des modifications génétiques, opèrent de manière naturelle. Au cours de nos échanges, un autre point est grandement ressorti, concernant la distance qu’il existe entre le débat politique et le débat scientifique autour de la recherche. Les chercheurs produisent des connaissances en quantité importante, et malgré une opacité qui s’entretient dû à la multitude de positions et d’informations, nous n’arrivons pas aujourd’hui à faire consensus. Le lobbying, plus fort que jamais, ferait partie des raisons principales qui ralentissent cette recherche d’un point d’accord.
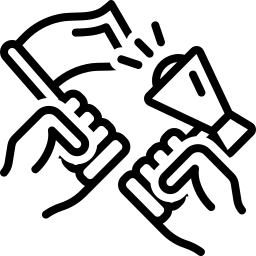
François Veillerette
François Veillerette, porte-parole et co-fondateur du syndicat Générations Futures, nous a également fait l'honneur de participer au projet du podcast. Il nous a éclairé sur le point de vue que soutient son association et de la manière par laquelle une association lutte pour son combat. Nous le remercions !
Dans cet entretien, notre but était d’en savoir plus sur la position d’une association défendant la cause d’une agriculture avec moins (ou absence totale) de pesticides. Cela implique donc de suivre l’évolution du débat autour des OGM/NTG. Ce qui ressort de cet échange, c’est que, selon eux, les OGM contribuent à augmenter l’utilisation des pesticides. Ils se positionnent donc contre l’utilisation des OGM, et plus récemment des NTG, car cela ne serait pour eux qu’un moyen d’échapper aux réglementations et pourrait renforcer la dépendance des agricultures aux grandes firmes agrochimiques. La rémunération suffisante des agriculteurs est une autre cause qu’ils cherchent à défendre, pour eux, cela nécessite d’entretenir des charges et des coûts fixes pour les agriculteurs. Autoriser la multiplication des semences, privilégier les circuits courts et arrêter d’ajouter des contraintes aux agriculteurs sont des solutions qu’ils soutiennent et qui iraient en faveur de l’objectif d’alléger la pression économique et restrictive sur les épaules de nos agriculteurs. Nous lui avons également demandé s’il pensait que les OGM/NTG pourraient être une aide pour régler les problèmes de sécurité alimentaire dans certaines zones du monde. Selon lui, si des OGM sont arrivés en Afrique, c’est principalement en raison des grandes firmes, qui cherchent à vendre plus. Il pense que nous devrions prioriser notre propre autonomie alimentaire avec des méthodes agricoles plus responsables avant d’exporter à l’étranger.
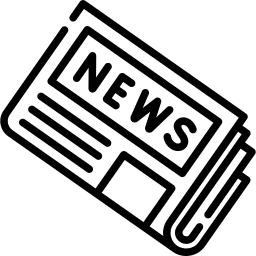
Christophe Noisette
Christophe Noisette est rédacteur pour Inf’OGM, une association créée en 1999, qui propose un service d’information sur les OGM, les biotechnologies, les brevets et les semences. En participant à notre podcast, Christophe Noisette nous a permis d’en apprendre davantage au sujet des OGM et des NTG. Nous le remercions fortement !
Durant cet interview, nous avons eu l’occasion de discuter de nombreux sujets : Durant cet interview, nous avons eu l’occasion de discuter de nombreux sujets. Selon lui, les nouvelles techniques génomiques (NTG) sont finalement des OGM (il ne faudrait pas les différencier). Même si le nom est différent, fondamentalement, les différences sont faibles. Il n'y a pas de différence scientifique ou philosophique significative entre la transgenèse classique et les NTG. Selon lui, il s’agit surtout d’un changement de nom pour redonner une nouvelle image et éviter d’effrayer les populations. Les raisons de l'utilisation des NTG sont dues à un désir d'extension et de contrôle sur la nature, dans le but de faciliter les pratiques culturales dans le domaine agricole. Les plantes transgéniques réalisées sont principalement des plantes tolérantes aux herbicides ou des plantes produisant leurs propres insecticides. Ces plantes facilitent les pratiques agricoles, mais peuvent également entraîner une augmentation de l'utilisation de produits chimiques (en opposition avec les avantages imaginés au départ). Ces plantes peuvent avoir un impact sur la biodiversité, notamment avec des problèmes de coévolution entre les espèces modifiées et les espèces sauvages dans l'environnement (on introduit des espèces totalement nouvelles dans la nature). Les cultures modifiées génétiquement peuvent contaminer les champs naturels par la biologie et par l’activité humaine tout au long de la chaîne agroalimentaire. On peut également se poser des questions concernant l’appropriation du vivant et les brevets. Les OGM et NTG permettent de breveter le vivant, menaçant la biodiversité cultivée et le contrôle des agriculteurs sur les semences. Concernant les préoccupations sanitaires, les études sont encore trop peu nombreuses et peu fiables. On observe un manque d'études approfondies sur le long terme. Nous avons pu aborder le sujet des perspectives d'avenir ainsi que la législation européenne. Certains États s’opposent à l’utilisation des OGM, notamment par rapport à la brevetabilité du vivant. Cependant, étant donné que le Danemark prendra la présidence de l'Union européenne, les discussions pourraient s'accélérer à l’avenir, puisque le Danemark fait partie des pays favorables aux OGM. À l’échelle européenne et mondiale, on observe des différences entre les pays. Par exemple, l'Europe est en majorité contre l’utilisation et le développement des OGM tandis que certains pays comme l'Argentine et le Japon y sont favorables et adoptent des réglementations par conséquent très légères à leur égard (pas d’étiquetage, pas de traçabilité et peu d’évaluations).